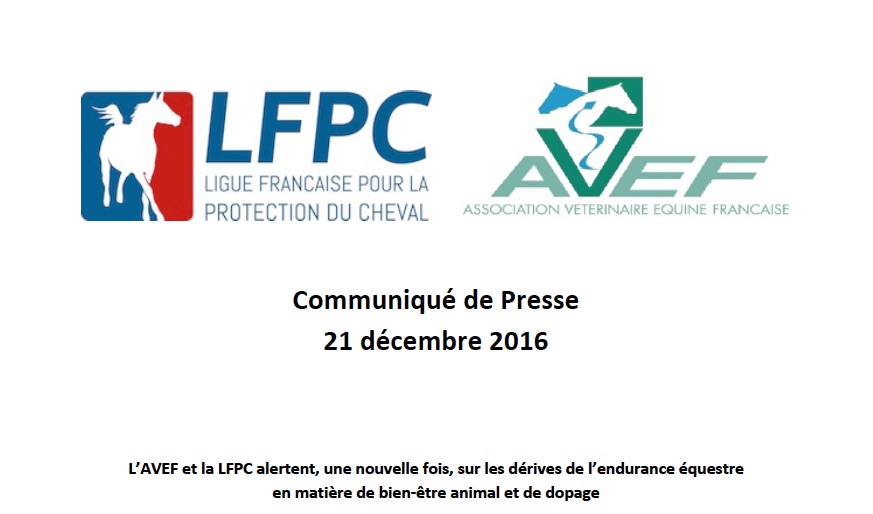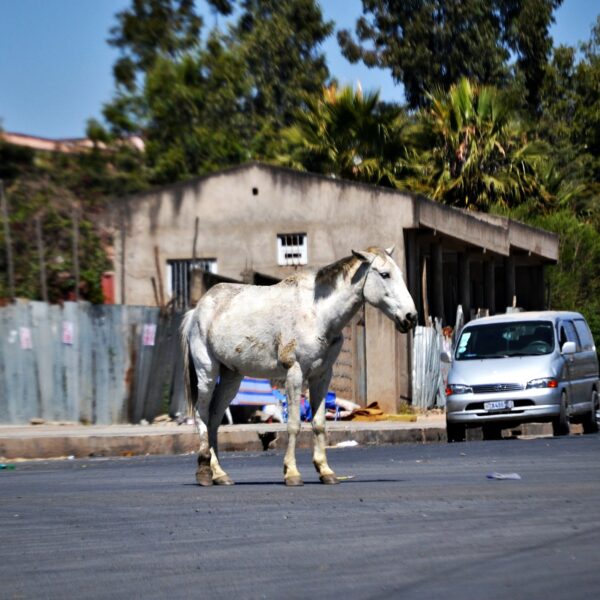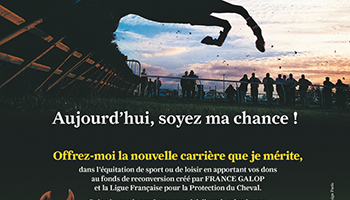Une étude révèle, à partir d’un vaste questionnaire en ligne, les changements comportementaux marqués présentés par les chevaux survivants au cours des 24 heures suivant la perte d’un compagnon de paddock ou d’écurie.
Les signes de détresse les plus fréquemment observés chez un cheval à la suite de la mort d’un congénère sont une surexcitation (chez 89 % des chevaux), une hypervigilance (73 %), des vocalisations (69 %) et la modification des interactions avec les autres chevaux et les humains (78 %). En pratique, permettre au cheval survivant de passer du temps avec le cadavre de son compagnon ne change pas l’intensité des réactions immédiates, mais semble atténuer certains changements comportementaux qui persistent jusqu’à six mois après cette disparition.
Une détresse bien réelle
Les propriétaires interrogés rapportent, au cours des premières 24 heures, des modifications notables du comportement de leur animal. À moyen terme, l’évolution diverge selon la gestion au moment de la mort : chez les chevaux qui ont eu accès au corps, les chercheurs notent moins de réactions exacerbées et durables que chez ceux qui n’ont pas pu s’en approcher. Ces résultats ne démontrent pas l’existence d’un sentiment de deuil au sens humain du terme, mais objectivent une réaction de détresse face à la disparition d’un congénère, avec une évolution dans le temps et un effet selon la gestion du cadavre difficiles à ignorer.
Ces travaux s’inscrivent dans une littérature encore rare sur le deuil chez les équidés, mais cohérente avec des observations dans d’autres espèces sociales. Le protocole repose sur une enquête standardisée et une analyse statistique des réponses. Si l’étude ne remplace pas des observations expérimentales sur une durée et des effectifs plus importants, elle comble un angle mort en rapportant des situations réelles vécues par des centaines de chevaux au moment de la mort de l’un d’entre eux.
Implications pratiques pour les propriétaires
L’étude prône une gestion ritualisée et transparente au moment de la mort. Laisser le survivant approcher et renifler le corps, dans un environnement calme et sécurisé, n’empêche pas les réactions aiguës mais peut réduire les perturbations plus durables. Les semaines suivantes, l’accent doit être mis sur la stabilité des routines (horaires des soins et de la distribution d’aliment, sorties), la qualité du sommeil et de la prise alimentaire (surveillance de l’appétit, du poids, de la consommation d’eau), ainsi que sur un enrichissement social graduel (contacts visuels et tactiles contrôlés avec un autre cheval, introduction progressive d’un nouveau compagnon si cela est envisagé, renforcement du lien avec l’humain lorsque le cheval le recherche…).
Le message à faire passer aux propriétaires est d’éviter tout anthropomorphisme et projection d’émotions humaines sur l’animal. Il s’agit plutôt de reconnaître la sensibilité sociale du cheval, de parler de “réactions de détresse compatibles avec une sensation de deuil”, de lister les signes à surveiller, et de proposer une conduite à tenir face au survivant.
Pistes à suivre dans une structure équestre
La prévention se joue en amont, en identifiant les binômes ou les groupes liés par un attachement fort, en rédigeant une procédure pour le jour de la mort de l’un d’eux (sécurisation des lieux, temps d’exposition du corps, personnes référentes) et en organisant un suivi à deux, quatre et six semaines des chevaux concernés. L’objectif n’est pas de chercher à dissimuler la mort d’un congénère, mais d’accompagner les survivants pendant une phase d’adaptation qui, chez certains chevaux, peut durer plusieurs mois.
Une autre piste consiste à mesurer, chez les chevaux suivis, la variabilité des biomarqueurs de stress (cortisol, fréquence cardiaque) pour objectiver le mal-être ressenti, et à croiser les différents profils d’attachement avec l’évolution des réactions observées. L’enjeu est double : assurer le bien-être des chevaux survivants et fournir aux praticiens des repères objectifs pour décider quand et comment réaménager leur environnement social lors de la perte d’un compagnon.