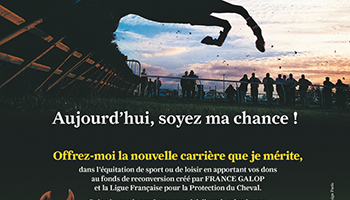À Buenos Aires, une entreprise de biotechnologies a fait naître cinq poulains clonés d’une jument de polo d’élite et génétiquement modifiés par la technologie Crispr-Cas9 via le gène MSTN (myostatine) pour favoriser la croissance musculaire. L’Association argentine de polo a aussitôt interdit ces chevaux en compétition, déclenchant un débat mondial où s’entremêlent performance, bien-être, équité sportive, éthique et réglementation.
Ce qui change scientifiquement… et ce que l’on ignore
Techniquement, cette modification Crispr du génome réduit le “frein” physiologique à l’hypertrophie musculaire. Sur le papier, l’avantage attendu est une amélioration des performances sportives, notamment une puissance et une vitesse décuplées. En pratique, seule une évaluation longitudinale (appareil locomoteur, tendons, métabolisme, récupération, longévité sportive) permettra de dire si le résultat est un cheval plus performant, ou simplement un cheval différent. Les autorités argentines ont validé cette technologie de modification de l’ADN, mais l’entreprise a gelé la commercialisation de ses “super” chevaux tant que la filière n’a pas clarifié ses règles.
Clonage toléré, manipulation génétique refusée : une frontière mouvante dans les sports équestres
Le clonage est autorisé dans la plupart des disciplines de la Fédération équestre internationale (FEI) depuis 2012, après des années de débats, et il s’est banalisé au plus haut niveau du polo argentin. À l’inverse, les instances sportives ont fermement proscrit l’usage non thérapeutique des techniques de modification du génome. En 2025, la FEI a explicité dans ses règlements antidopage équins les définitions de la thérapie génique, et de l’édition génomique, en les intégrant à la liste des méthodes interdites. L’Association argentine de polo (AAP) s’est alignée en bannissant les chevaux génétiquement modifiés des compétitions. La British Horseracing Authority (BHA) a, de son côté, annoncé l’intégration des tests de dopage génétique dans ses prélèvements de routine.
Sous l’angle éthique
Quatre questions dominent l’aspect éthique de cette pratique.
- Naturalité : l’édition génomique recrée des variants déjà observés dans la nature, mais le rythme et la certitude du résultat n’ont plus rien d’aléatoire.
- Équité : l’avantage génétique obtenu peut être assimilé à un dopage génétique dès lors que la modification vise la performance et qu’elle est inaccessible à la majorité des éleveurs, créant un marché à deux vitesses.
- Bien-être animal : tout gain de puissance a un coût biomécanique potentiel (tendons, dos, récupération). Il y a donc une obligation morale à démontrer l’innocuité sur le moyen terme.
- Esprit de la discipline : le polo, comme d’autres sports équestres, valorise l’élevage et l’art du dressage. L’édition génomique déplace l’excellence vers le laboratoire, ce que beaucoup jugent incompatible avec la tradition et la performance zootechnique. Ces tensions expliquent la prudence de la filière et la demande de périodes d’observation avant tout enregistrement officiel.
Le dopage génétique, une pratique déjà codifiée
Dans le sport humain, l’Agence mondiale antidopage (AMA) classe les modifications de gènes et de cellules parmi les méthodes interdites en permanence (M3), ce qui englobe le transfert de gène, l’édition génomique et les cellules modifiées. Le milieu des courses a également sa doctrine : l’International Federation of Horseracing Authorities (Ifha) définit le dopage génique, interdit « en course comme en élevage », comme l’usage de l’édition génomique ou de la thérapie génique pour altérer le génome ou l’expression génétique. La FEI a élargi en 2024-2025 son cadre antidopage équin pour y inclure explicitement ces méthodes. Autrement dit, les techniques de manipulation du génome visant à augmenter la performance sont considérées comme du dopage sportif, même si elles ne reposent pas sur une substance détectable par des tests classiques.
Détection et traçabilité : du test de terrain au passeport génomique
Pour détecter le dopage génétique, les autorités combinent désormais des tests ciblés, des biomarqueurs d’ARN et des contrôles en élevage. Le défi est double : distinguer les chevaux nés d’un processus biologique et ceux issus d’une manipulation génétique, et garantir la traçabilité du poulain destiné à une carrière sportive. D’où l’idée d’un passeport génomique dès l’enregistrement à la naissance, sécurisé et contrôlable, qui clarifierait le statut du cheval (issu de la reproduction naturelle, cloné ou génétiquement modifié) sans stigmatiser les clones, autorisés depuis 2012 par la FEI. La BHA a beaucoup investi dans la recherche pour prendre en compte ces risques et mettre au point des tests plus sensibles et spécifiques, avant même tout scandale avéré.
Conséquences socio-économiques : promesse d’excellence ou fracture du marché ?
Si l’édition génomique produit immédiatement ce que la sélection génétique met des générations à obtenir, la balance de l’avantage compétitif pourrait pencher vers les acteurs capables d’absorber les coûts de recherche et développement, de gestation par juments porteuses et de clonage. Les éleveurs traditionnels redoutent ainsi un effet d’éviction et la dévalorisation de leur savoir-faire. À l’inverse, les partisans de cette technique y voient un accélérateur de la diversité naturelle, utile face aux crises climatiques ou sanitaires. La décision de l’AAP de bannir pour le moment les chevaux génétiquement modifiés des terrains de polo laisse le secteur dans l’expectative. Cela lui donne néanmoins le temps de produire des données sur la sécurité et la supériorité sportive réelle des poulains Crispr.
Verdict provisoire : l’innovation oui, mais sous conditions
Si la capacité technologique de modifier le génome du cheval est démontrée, la légitimité de son usage pour doper la performance sportive ne l’est pas. À court terme, la distinction entre clonage autorisé et édition génomique interdite restera la ligne rouge opérationnelle, autant en matière d’éthique que d’équité en compétition. À moyen terme, l’issue dépendra moins des promesses marketing que des faits vérifiables et des règles applicables : c’est le prix à payer pour que la filière équine concilie excellence, bien-être animal et confiance du public.